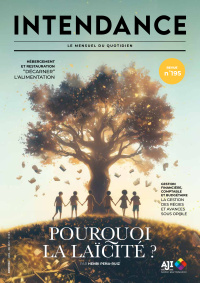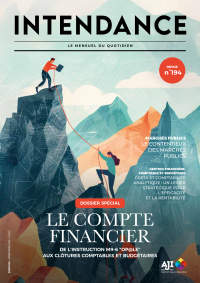En 2025, les EPLE ont 40 ans
par Roland Delon, ancien vice-président d'AJI
Cette année les EPLE fêtent leurs 40 ans.
À cette occasion, nous vous proposons de revivre en 10 étapes les moments marquants de l’histoire des établissements scolaires.
1° Pour inventer l’EPLE, il faut d’abord créer le lycée
L’œuvre de Napoléon Bonaparte est probablement critiquable dans plusieurs domaines mais on ne peut lui retirer les efforts colossaux accomplis pour la réforme de l’État. A partir du Consulat, l'objectif de réconcilier les français et de stabiliser la nation après les convulsions révolutionnaires, l'amène à affirmer l'unité et l'indivisibilité de pays et à concevoir une réorganisation profonde de l’État. Cela va se traduire, entre autres, par l'unification du droit français dans le Code Civil de 1804, le Code du Commerce de 1807, le Code Pénal de 1810… Le système éducatif ne sera pas oublié et sera même traité en priorité après le Concordat religieux de 1801...
Lire l'article en intégralitéÉpisode 2 : L’évolution du lycée au 19e siècle
Du Concordat religieux napoléonien de 1801 jusqu'à la séparation de l’Église et de l’État par la loi de 1905 le lycée ne connaîtra pas de réorganisation profonde. Il maintiendra son statut d'établissement élitiste de garçons (le premier lycée de filles n'ouvrira qu'en 1880 autorisé par la loi Camille Sée toutefois les filles ne pourront passer le bac qu'en 1924), chargé de former les fils de notables aux emplois de l'administration, de l'armée. Il sera évidemment concerné par les luttes d'influence qui vont durer tout le siècle entre les idées républicaines de laïcisation de l'enseignement public et les résistances opposées par l'enseignement religieux. Le grand débat qui va naître au 19e siècle au sein du lycée concerne plutôt le contenu des études et l'adaptation des programmes scolaires aux besoins de la société. C'est l'homme politique Hippolyte Fortoul, devenu ministre de l'Instruction publique en 1851, qui souhaite réformer en profondeur l'enseignement secondaire. Il considère que les programmes alors enseignés, notamment les humanités classiques (latin, grec), la prééminence des formations à dominance littéraire sont devenues anachroniques et ne répondent plus aux exigences d'une société moderne. Il va donc s'efforcer d'introduire dans les programmes des enseignements scientifiques (mathématiques, physique, chimie, sciences naturelles) et de promouvoir également les langues vivantes...
Lire l'article en intégralitéÉpisode 3 : Début du XXe siècle : les premiers pas de la démocratisation
Pour inventer l'EPLE, il faut créer le lycée et Napoléon s'en est chargé par la loi fondamentale du 1er mai 1802. Nous avons vu précédemment que le XIXème siècle verra se confronter deux ordres scolaires, l'un représenté par l’Église et ses congrégations qui défendront avec acharnement leur privilège exclusif sur l'enseignement scolaire datant du Haut Moyen-Age, l'autre porté par les idées républicaines et laïques qui revendique au nom de l’État la neutralité de l'enseignement. Ce n'est qu'à la fin du siècle, avec l'avènement de la 3e république après la défaite de Sedan, que la bascule politique interviendra en faveur de l'école républicaine grâce aux lois de Jules Ferry suivies bientôt par la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État. Au début du XXème siècle, si la publicisation de l'enseignement secondaire est acquise, la démocratisation reste à faire...
Lire l'article en intégralitéÉpisode 4 : Le « baby-boom » de l'après-guerre vecteur de la démocratisation scolaire
La longue marche vers l'EPLE actuel est semée de multiples obstacles qui seront franchis progressivement, dans la deuxième moitié du XXe siècle par de multiples réformes visant à donner à tous les enfants d'une classe d'âge un même cursus de formation.
Les efforts de la Troisième république et du Front populaire (Cf. œuvre de Jean Zay) pour ouvrir l'enseignement secondaire au plus grand nombre (prolongation de la scolarité jusqu'à 14 ans, gratuité des études, dédoublement des classes de 35 élèves...) furent contrariés par la funeste période de 1940 à 1944, pendant laquelle l’État français édicta une législation éphémère rétrograde, caractérisée par la suppression des Écoles normales, par des subventions importantes allouées aux écoles privées, par la violation de la neutralité scolaire et la tentative (non réussie) d'introduire l'enseignement religieux à l'école publique, par l'étouffement de la pensée libre et le reniement des principes républicains de liberté, égalité, fraternité.
Épisode 5 : La réforme Haby de 1975 : on arrête de séparer le bon grain de l’ivraie
On a vu que la démocratisation de l'enseignement scolaire, notamment dans les collèges, est bien lancée à partir des années soixante jusqu'au milieu des années soixante-dix. La poussée de la scolarisation se confirme par le passage de deux à trois millions d'élèves qui subissent toutefois un aiguillage scolaire les orientant dans différentes filières et même différents établissements puisque persiste encore dans le premier cycle les CEG et les CES.
La loi Haby du 11 juillet 1975 supprime la distinction entre les CES et les CEG qui deviennent tous des collèges. Elle met fin à l'organisation de la scolarité en filières, c'est le collège unique où s'établit l'hétérogénéité des classes, les différences de niveau scolaire sont traitées par des actions de soutien et d'approfondissement. Le BEPC (brevet d'études du premier cycle) disparaît et est remplacé par le brevet des collèges. La loi Haby, qui va prendre effet à la rentrée 1977, précise également que les lycées et collèges ne se différencient plus par leur statut juridique mais par leurs fonctions, ils constituent les uns et les autres, en application du décret n°76-1305 du 28 décembre 1976 qui régit leur organisation administrative et financière, des établissements publics nationaux d'enseignement à caractère administratif.
Épisode 6 : Les conséquences du collège unique : un maelstrom de réformes
Avant d'aborder dans le prochain épisode la révolution institutionnelle et juridique que sera la création de l'EPLE avec l'arrivée des collectivités territoriales comme nouvel opérateur du service public de l'enseignement, il convient de regarder les effets de cette révolution, celle-ci pédagogique, que fut l'instauration du collège unique. La loi Haby, qui prend effet à la rentrée de 1977 répond d'une part aux aspirations de la population à accéder à un niveau supérieur de formation, et d'autre part aux besoins de l'économie qui doit disposer d'une main d’œuvre mieux formée. Ce n'est plus à 11-12 ans qu'on choisit sa voie mais plutôt à 15 ans. On a unifié le collège par le haut en s'alignant sur le modèle du lycée au lieu de le faire, par le bas, dans la continuité de l'enseignement primaire. La massification du premier cycle a été instaurée sans modifier le contenu des enseignements, les méthodes pédagogiques, quant à elles, n'ont guère évolué en profondeur. Les difficultés étaient inévitables. Le maintien au collège, jusqu'à 16 ans, d'élèves qui arrivent du primaire avec des lacunes dans les disciplines de base, le redoublement peu utilisé et qui sera d'ailleurs abandonné, l'hétérogénéité des publics par leur niveau scolaire et leur origine sociale, tous ces facteurs vont entraîner l’échec scolaire d'une partie des élèves et faire naître une nouvelle typologie de collégien, le décrocheur. On a voulu faire du collège « un petit lycée » sans se doter des moyens nécessaires
Lire l'article en intégralitéÉpisode 7 : décentralisation corollaire de la massification du 2nd cycle
Si la massification du second degré par l'instauration du collège unique et l'objectif de conduire 80% d'une classe d'âge au niveau du bac représente un des grands bouleversements scolaires de la fin du XX ème siècle, la décentralisation des années quatre vingts témoigne d'un même niveau de changement dans les domaines institutionnels, politiques et administratifs. Dans les grandes lois de décentralisation de 1982 et 1983 initiées par une nouvelle majorité de gauche arrivée au pouvoir, il faut distinguer deux actes. L'acte I concrétisé par la loi du 2 mars 1982 chamboule les institutions. Sous l'égide du ministre de l'Intérieur d'alors, Gaston Deferre, l'organisation des collectivités locales est transformée. Souvenons-nous qu'avant cette loi la Région est un établissement public depuis 1972, le Département est quasiment administré par la Préfet, organe exécutif qui contrôle « a priori » les actes de la collectivité. La loi du 2 mars confère un statut de collectivité de plein exercice aux départements et aux régions qui deviennent des personnes morales de droit public, investies de missions d'intérêt général, pourvues d'un organe délibérant élu au suffrage universel qui désigne son président. Elles s'administrent librement, le contrôle des actes s'effectuant désormais « a posteriori ».
Lire l'article en intégralitéÉpisode 8 : L’EPLE établissement public local versus établissement public national
Les collèges et lycées étaient des établissements publics nationaux, par la loi de 1983 et surtout le décret fondateur du 30 août 1985 (aujourd'hui abrogé car codifié dans le Code de l’Éducation au titre II du livre IV de la partie réglementaire) ils deviennent des établissements publics locaux. Cette innovation juridique laissera perplexe les experts du droit administratif, le Recteur Toulemonde parlera même à propos de ce nouveau statut de l'EPLE « d’OJNI»… objet juridique non identifié… Les collectivités dans l’Éducation ce n’était pas nouveau. Les communes depuis la loi Guizot de 28 juin 1833 et les lois Ferry de 1882-1883 participaient à la gestion du système éducatif en étant propriétaires des écoles élémentaires, responsables des travaux de construction, grosses réparations, fournissant les équipements, finançant le fonctionnement et gérant la restauration scolaire. Mais l'école primaire n'a jamais été pourvue de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, elle reste donc un service annexe de la municipalité géré en partenariat avec l’État. Toutefois ce statut reste discuté, témoin la proposition de loi déposée le 21 décembre 2021 par la députée Cécile Rilhac demandant la transformation des écoles en établissements publics locaux d'enseignement primaire (EPLEP)...
Lire l'article en intégralitéÉpisode 9 : Les collectivités territoriales font irruption dans les EPLE
Bien sûr la première décentralisation du système éducatif dans le secondaire lors des années 1982-1983 brise un tabou institutionnel : les départements et régions obtiennent des compétences dans le fonctionnement des EPLE. Mais à bien y regarder quel a été le contenu de ce premier investissement : envoyer des architectes, bureaux d'études, entreprises du BTP pour remettre à niveau un héritage patrimonial sensiblement dégradé et tenir à disposition des établissements une ligne téléphonique et l'accès à un chéquier pour leurs divers financements. Il faut dire que cette première incursion dans la vie des établissements se traduira par une réussite ne faisant guère débat. Les collectivités vont consacrer une part substantielle de leurs budgets à construire, rénover, aménager des locaux satisfaisants à destination des collégiens et lycéens et à donner aux équipes de direction les moyens financiers nécessaires à leur autonomie. Fort de ce bilan positif les collectivités vont souhaiter exercer des responsabilités plus importantes en intervenant dans le champ des politiques éducatives.
Lire l'article en intégralitéÉpisode 10 : L’EPLE dans 40 ans : projections (gratuites) d’évolution
Au terme de cette étude qui suit le parcours de l'enseignement secondaire en France depuis le lycée napoléonien jusqu'aux décentralisations du XXIe siècle, on peut essayer d'envisager, avec toutes les réserves qui s'imposent, les trajectoires d'évolutions possibles dans les années à venir. Ce dossier en traitant des réformes institutionnelles et administratives qui ont touché les collèges et lycées a volontairement laissé de côté les nombreuses réformes pédagogiques qui ont émaillé ces quatre décennies passées, même si les unes impactent fatalement les autres. S'il fallait retenir deux changements de structure essentiels qui ont transformé la scolarité du secondaire, on pourrait mettre en exergue l'affirmation du collège unique, « le collège pour tous » et l'arrivée des collectivités territoriales comme opérateurs publics de l'enseignement secondaire.
Lire l'article en intégralité